Daisy Bates en Australie profonde
tania navarro swain [1]
Résumé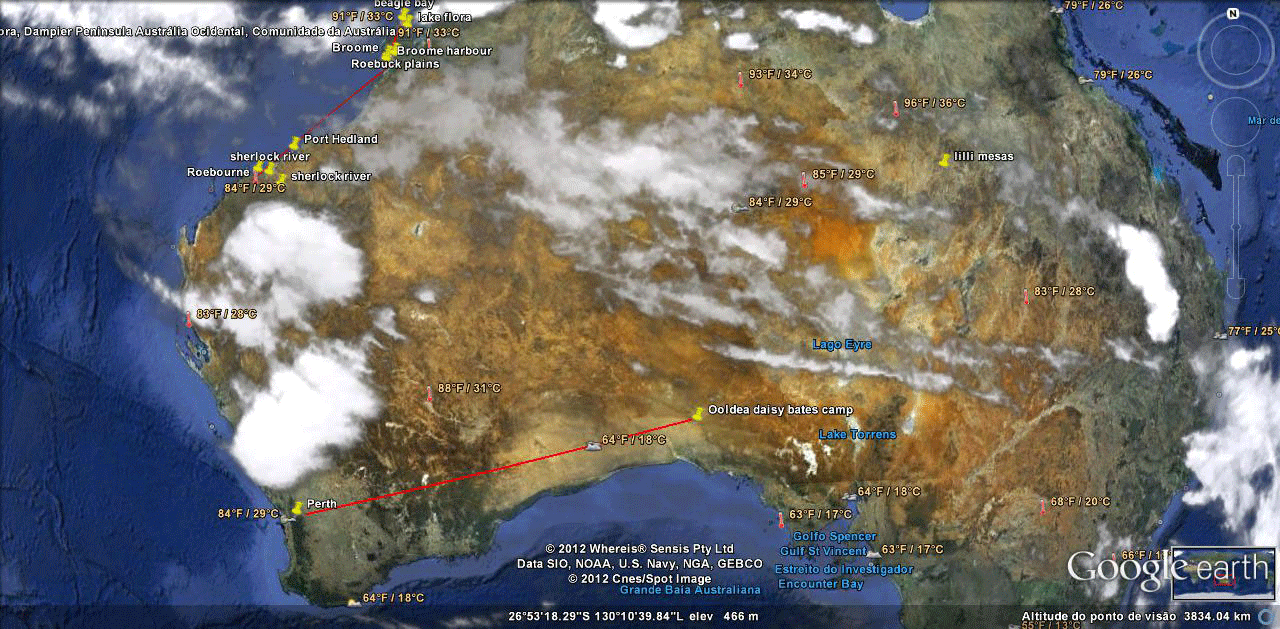
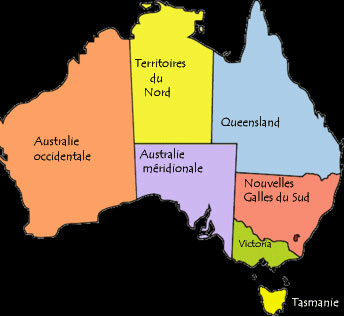
Les aborigènes l´appelaient Kabbarli , la Grand-mère. Elle a vécu parmi eux pendant 35 ans.
Quel instiguant personnage, habitant en plein désert, sous une tente, loin de l´eau et de la moindre végétation, toujours très habillée par une chaleur qui frôlait les 500 .
Sa maison était une tente, on ne sait pas très bien comment elle se ravitaillait, comment était sa vie dans le désert, car elle ne parle presque pas de ces détails. Lorsqu´elle occupait son camp, les aborigènes venaient la voir de toute part ; sinon, elle était en déplacement continu, pour aller à leur rencontre; on sait qu´il fallait marcher presque deux kilomètres pour aller chercher de l´eau. On sait aussi que la chaleur était écrasante dans le campement où elle est restée 16 ans. La terre rouge, le soleil implacable, la poussière du désert, le ciel ardent d´un bleu impitoyable. Quels rêves sous-jacents pouvaient soutenir une telle détermination ? Quel désir d´aventure la poussait à traverser des milliers de kilomètres sur une terre aride, où elle se trouva tant de fois épuisée et assoiffée ?
« I made the decision to dedicate the rest of my life to this fascinating study. I admit that was scarcely a sacrifice. Apart from the joy of the work for its own sake, apart from the enlightenments, the surprises, the clues, and the fresh beginnings that were the stimuli of every day, the paths to never-ending high-roads and byways in a scientific study that was practically virgin country […] meant much more to me now than the life of cities.” (99)
Les aborigènes sont devenus sa famille, son port d´attache, sa raison de vivre. Pour eux, elle s´est dépouillée afin de les nourrir et les soigner et décida ainsi de tout vendre ce qu´elle possédait. Elle est morte dans la pauvreté. Aurait-elle sauvé quelqu´une, quelqu´un, aurait-elle recousu les haillons d´une culture en perdition ?

Sidney Nolan [Daisy
Bates] 1950, Sydney, New South Wales, Australia
Painting, enamel and oil on composition board
Daisy May Bates (1863-1951), irlandaise, est partie vers l´ Australie en 1883 à la recherche de nouveaux horizons. Elle travaille alors pour subsister et devient gouvernante dans un ranch. Certains de ses biographes, cependant, tiennent à raconter des histoires sur sa vie personnelle, ses liaisons amoureuses, car ils cherchent à connaître sa « vraie » vérité.
Pour une femme, à l´évidence, la vérité se trouve dans le corps. Lorsqu´il s´agit des narratives de vie des femmes, le mariage, les enfants, la sexualité sont toujours posés comme les jalons principaux. Le fait qu´elle ait vécu parmi les aborigènes pendant des décennies leur prodiguant soins, amitié, les protégeant (notamment les femmes) contre les Blancs leur paraît secondaire. Et pourtant, au delà des maris, amants, fils, DB détermine ses priorités: la science, la connaissance, l´approche, et la rencontre de l´autre.
En tant que femme d´aventure ce qui importe, en fait, c´est son esprit indomptable, son courage d´affronter les colons, son amour pour les aborigènes, une femme parmi d´autres qui a pris son destin en mains et a cassé le ciment des normes. Elle a creusé les sillons de sa destinée, a construit sa vie comme elle l´entendait et ce, au milieu des autochtones, dont les mœurs étaient littéralement aux antipodes des siennes. Ainsi, elle a tenu à marquer son personnage par son habillement particulier. : chapeau, haut col, manches et jupe longues, gants, chaussures lacées, petite cravate. Les gants se sont d´ailleurs avérés très utiles pour éviter les infections et les blessures dues aux rudes travaux manuels qu´elle effectuait.
« I have always preserved a scrupulous neatness, and all the little trappings and accouterments of my own very particular mode of dress, sometimes under difficulties, [..]”(16)

Journaliste, Daisy Bates travaillait pour la Review of Reviews à Londres et a été chargée de faire une recherche sur la vie des aborigènes. En 1904, elle est nommée par le gouvernement d'Australie-Occidentale pour étudier les tribus aborigènes, leurs langues, dialectes et coutumes, mais avant cette nomination elle était déjà sur le terrain. Elle a écrit plusieurs dictionnaires et était capable de communiquer en 188 langues sur les 250 existantes parmi les aborigènes. La qualité de ses travaux lui valut leur lecture lors des séances tenues par la Royal Society et la Geographical Society.
Elle a sillonné l´Australie méridionale et occidentale lors de ses nombreux voyages, toujours occupée à prendre des notes, à vérifier les conditions de vie des aborigènes, à ausculter leurs mystères. Son travail était de les écouter, de se renseigner sur les profondeurs de leurs mythes, du « temps du rêve », de la magie qui traversait leurs vies et leurs relations entre tribus.
« They explain in detail the purpose of all weapons and implements [...] they let me watch their making and the chipping of stone tools, and told me the half-legendary stories of their origin. Dances and songs were explained to me at symbolic and play-corroborees, and so we progressed naturally from the world of actuality to the dream world”. (22)
DB écoute et note tout, puis nous raconte les légendes des aborigènes, dont celle du Jimbin, le pays souterrain des enfants, où il n´y a pas de luttes ni de bagarres, même la mort y est absente et l´on n´y entend que: [...] the happy laughter of the little people at play ». (23)
En 1938, elle publie The Passing of the Aborigines, livre que j´utilise ici comme source principale où elle y a consigné ses observations. Son oeuvre, cependant, compte des dizaines d´articles sur les aborigènes, qui ont été publiés dans des journaux et des revues scientifiques.
Parfois, elle raconte le côté pittoresque de ses voyages :
« Shortly after I landed in Perth I obtained a buggy and horses and camp-gear, and journeyed by sea to Port Hedland. I stayed at a licensed shanty with earthen floors and blue blankets where the hermit crabs from the seashore nibbled my feet every time I put them to the floor. I then traversed in my buggy eight hundred miles of country, taking six months to accomplish it”. (2)
L´empathie avec les aborigènes a été foudroyante : dès leur toute première rencontre, sa préoccupation était non seulement de les soigner et les protéger contre les exactions des colons, mais aussi de chercher les significations et les valeurs qui orientaient leur vie. Pour cela, elle apprend leur langue, participe à leurs rituels, se penche sur leur légendes qui définissent les totems de chaque groupe. Très vite elle est capable de communiquer avec eux.
Arthur Mee, qui a écrit la préface de son livre, affirme que:
« She knows them as they know themselves. She knows their languages, their rituals, their traditions, their capacities and their incapacities, as no white man or woman on the earth know them. She can talk to them in 188 dialects […] She is a magical figure to them.”(XII)
Sa vie s´est imbriquée dans celle des aborigènes et elle est devenue leur championne et leur appui. Leur Kabbarli, la grand-mère, vers laquelle ils accouraient pour se faire soigner et protéger. Elle donne quelques détails sur sa vie dans un de ses campements :
« A circular tent, 14 ft. in diameter, sagging about me in the wet and ballooning in the wind, was my home for two years in that little patch of bushland bright with wild flowers, overlooking the beautiful valley of Guildford and the winding river. There by a camp-fire when the dampers were cooking, or in the winter sitting on the ground by a fire inside their mia, I would be on duty from night till morning, collecting scraps or language, old legends, old customs, trying to conjure a nation of the past from the few and homeless derelicts, always in haste, as they died about me one by one, in fear lest I should be too late.” (58-59)
En 1899 Daisy Bates entreprend un voyage à partir de Perth, sur environ 1200 km pendant 6 mois, à bord d´un buggy tiré par des chevaux ; de campement en campement elle rencontre les aborigènes nomades et peut constater la véracité des dénonciations d´atrocités commises contre eux.
Le population des aborigènes diminuait à vue d´œil et Daisy craignait qu´ils ne puissent survivre au contact des Blancs, crainte d´ailleurs très légitime. Le danger venait non seulement de la violence des colons, mais aussi des maladies qu´ils apportaient et qui décimaient les natifs par milliers, de la grippe aux maladies vénériennes. D´autre part, l´expulsion progressive des aborigènes de leurs chemins traditionnels les éloignaient des points d´eau, vitaux pour leur survie nomade sur ces terres arides. Et elle devient une farouche défenseure de leur culture, de leurs vies et de leur habitat.
« My first camp was established on the Maamba Reserve near the present National Park, a few miles from Cannington [...] in the early years of this century a beautiful kingdom of bush still rich in native foods and fruits. The Bibbulmun race was represented by some thirty or forty stragglers, and these would gladly have gone back to their own various grounds; but their health and sight had failed.” (53)
Le nombre des aborigènes avait été estimée à un million d´individus lors de l´arrivée des Anglais sur le sol d´Australie au XVII siècle. Au début du XX siècle des tribus entières étaient déjà disparues[2]. La Tasmanie fut totalement dépeuplée et ses derniers ressortissants ont été déplacés sur d´autres îles. Étant donné leur résistance, le choc avec les anglais au début du XIX siècle a été appelé « la guerre noire ».[3]
Sur le continent, au fur et à mesure de l´avancée des colons sur leurs terres, les aborigènes ont dû se replier à l´intérieur du pays.
« The first landing of the white man was the beginning of the end. » (53) dit DB.
Mais leur résistance[4] se révéla un bon prétexte pour les massacres qui ont suivi.
Daisy Bates dénonce:
« Change the food, environment, outlook, the burying of the old traditions and customs, inhibitions and the breakdown of the law [...] Can we blame them for the reactions that found vent in violence in certain instances few and far between, punished sometimes with terrible reprisals on the part of the white man?” (56)
Comme dans toute colonisation qu´a connu l´histoire, les natifs ont été tués, malmenés, expulsés de leurs terres et arrachés à leur coutumes, discriminés, parqués dans des réserves, mis en esclavage ou utilisés comme main-d´œuvre à bas prix. Anglais, Français, Espagnols, Portugais, Hollandais, Allemands, partout où les Européens se sont installés, des exactions ont été pratiquées contre les peuples indigènes.
En Tasmanie et sûrement ailleurs en Australie, les aborigènes ont été mis en esclavage. La traite des femmes ne s´est pas fait attendre au profit des européens et des asiatiques. Daisy Bates, d´ailleurs, a mené une lutte acharnée pour protéger les femmes, qui étaient encore victimes de la traite et de l´exploitation sexuelle à son époque. Elle a débusqué cette pratique sous le couvert des mariages entre des hommes de Manille et des femmes aborigènes, prêtées alors à l´usage sexuel des « frères » ou « amis » du mari. (10-11)

Combattantes à part entière, les femmes aborigènes ont participé à la défense tant de leurs vies que de leurs terres, à l´arrivée des Anglais ; à l´exemple de Truganini (ci-dessous), considérée comme la dernière des aborigènes de Tasmanie, elles ont donc lutté lors de la « guerre noire ».
Truganini (ou Truganinny), née vers 1812 et décédée le 7 mai 1876
Autre pratique imposée par les Anglais fut l´enlèvement des enfants à leurs parents, pour les « civiliser » dans des orphelinats, des internats, ou bien confiés à des missions chrétiennes ou à des familles d'accueil blanches. On peut facilement imaginer le traitement qui leur était réservé et l´éducation qui leur était dispensée.

Pendant cent ans, de 1869 à 1960, les enfants qu´on a appelés les « Stolen Generations », ont subi cet abus. En 1999, le Parlement australien a adopté une motion, exprimant son regret pour l´emploi de cette pratique, mais ce n´est qu´en 2008 que l´ État australien a présenté ses excuses officielles, pour l´enlèvement forcé d´environ 100.000 enfants.
« Children of the woodland, dwelling in a squalor that could not be avoided in their stone-walled houses, closed in from the air that was their breath of life, in the heat of summer and the dark cold of winter, they lost all touch with their native earth.” (57)
Les Anglais obligeaient les aborigènes à se déguiser avec des habits « civilisés » de l´époque. C´était sans doute une manière des les humilier, de les ridiculiser et de les couper des leurs habitudes ancestrales, de leur imposer des valeurs chrétiennes complètement inconnues, telles la pudeur et la honte du corps.
« They slept in beds – but they could not learn cleanliness. They wore clothing, and developed chest complaints and fevers.” (57)

Une image des quatre derniers aborigènes tasmaniens de "lignée pure" vers 1860
Nomades, les aborigènes avaient l´habitude de déambuler nus, avec très peu de bagages. Ils comptaient sur les moyens traditionnels de survie, offerts par le bush ; ils dormaient à la belle étoile ou se construisaient des huttes avec des arbustes.

Hut decked with porcupine grass, Eastern Arrernte people, Arltunga district, Northern Territory[6]
Daisy Bates a connu cette expérience de vouloir changer leurs habitudes :
« Once, in my inexperience, I myself packed up a plenitude of provisions for them tied neatly in bundles on their heads with new shirts and trousers and medicines and other conveniences I thought they might need. A few days after they had gone, riding to an outlying windmill, I came across a snow-storm of the flour that they had playfully thrown at each other. The tea and sugar had been consumed at this first well, and the trousers and sundries were deposited in a tree-fork.” (2)
En 1824, le gouverneur George Arthur établit la ségrégation des aborigènes pour en finir avec leur résistance. Il offrait d´ailleurs des récompenses aux Blancs qui livraient des autochtones aux camps où ils étaient parqués. Cette politique n´a cependant empêché en rien les massacres de tribus entières, telles que celle de Myall Creek en 1838 et de Pinjarra en 1834. Le déplacement forcé des aborigènes a, semble-t-il, été pratiqué sur tout le territoire australien.
Au début des années 1900, DB part pour un long pèlerinage à la rencontre des tribus du Sud-Ouest de l´Australie. Elle n´y trouve que désolation : bien que le Gouvernement pourvoyait les tribus en denrées alimentaires, vêtements, lits et couvertures et même des cabanes en bois, les aborigènes n´en avait que faire et se contentaient de la farine, du sucre et de leurs huttes dans le bush, laissant de côté les aménagements qui leur étaient octroyés. (58) Comme le souligne l´auteure, les tribus étaient en pleine déréliction, terme qu´elle utilise maintes fois quand elle se réfère aux aborigènes déracinés, arrachés à leurs terres, leurs traditions, leurs formes de socialité.
Les clôtures qui s´étendaient partout - pour démarquer les ranchs, contre les lapins ou les dingos – étaient source permanente de conflits, car les aborigènes les défonçaient pour passer sur leurs chemins habituels.

« What a surprise the fences, and the sheep and horses and cattle within their boundaries [...] There was no more happy wandering in the interchange of hospitality. Sources of food supply slowly but surely disappeared, and they were sent away to unfamiliar places, compelled to change completely their mode of life, to clothe themselves in the attire of the strangers, to eat foods unfitted for them, to live within walls.” (55)
Daisy Bates voulait avant tout préserver leur manière de vivre, et les voir libres et heureux. C´est à cela qu´elle dédia sa vie. Mais c´était déjà trop tard, les tribus disparaissaient rapidement. À Perth, on comptait 70 tribus à l´arrivé des Anglais, mais quand DB décida de les contacter, elle n´en trouva aucune, seuls quelques individus avaient survécu. (50) Elle décida alors de vendre tous ses biens et vécut tant bien que mal une vie d´ascète, offrant ses ressources au bien être des Aborigènes. (105)
Dans le but de soigner les différentes maladies qui décimaient les Aborigènes, le gouvernement décida, en 1904, d´isoler les malades sur deux îles : Dorré pour les femmes et Bernier pour les hommes.(83) Ils/elles étaient ramassé/es un peu partout, sans distinction d´appartenance à la tribu, aux différents totems. Les aborigènes n´avaient pas l´ habitude de se trouver ensemble sans leurs attaches tribales. Arraché/es à leurs terres et à leurs traditions, pris dans l´étau des maladies des Blancs – maladies vénériennes, tuberculose, varicelle, grippe - ces îles étaient devenues pour les Aborigènes des mouroirs, malgré les installations hospitalières que DB avait estimées correctes. Ainsi, elle raconte :
« When I landed on Bernier in November 1910, there were only fifteen men left alive there, but I counted thirty-eight graves.[...] They were afraid of the hospital its ceaseless probings and dressing and injections were a daily torture. They are afraid of each other, living and dead. […] When the bleak winds blew, the movable huts were turned against them, facing each other, regardless of tribal customs, which meant mistrust and fear.” (84-85)
DB était là en mission officielle avec une Special Commision du gouvernement pour enquêter sur les conditions de vie des Aborigènes et veiller sur eux. (80) Sur l´île où était parquées les femmes DB n´a pas osé compter les sépultures. Épuisées par les maladies, les femmes s´ isolaient dans leurs peurs car « Companionship in misery was impossible to them, for there were so many spiritual and totemic differences. » (84)
Il y avait par exemple, le groupe du totem serpent, dingo, kangourou, opossum, poisson, dinde, chacun avec ses caractéristiques, chacun avec ses mystères et ses tabous. Pour les aborigènes, les totems étaient pourvus d´une intense magie et leur pouvoir pouvait, selon leurs croyances, être mortel.
En effet, en voulant bien faire, le gouvernement n´a en fait réussi qu´à leur rendre la mort encore plus douloureuse.
« They wanted nothing in the world but their old sand-beds and shelters and little fires [...] and the voices of their own kind. There is nothing you can give them but freedom and their own fires - hearth and home”. (86)
Les rares survivant/es était ramené/es sur le continent et laissé/es pour compte, alors qu´ils leur fallait retrouver leurs tribus parfois éloignées de centaines de kilomètres. DB s´est ingéniée à leur procurer des moyens de transport et les soins nécessaires, leur offrant réconfort et amitié : grâce à ses connaissances de leurs langues, elle leur apportait des nouvelles de leurs proches et minimisait ainsi leur isolement. Et on a commencé à l´appeler kabbarli, la grand-mère, celle qui les comprenait et qui leur inspirait confiance. Cette appellation l´a accompagnée toute sa vie en Australie et lui a permis de connaître profondément les significations qui tissaient leurs relations sociales et tribales. (89)
L´incompréhension entre Anglais et aborigènes était complète et les Blancs sévissaient lorsque les coutumes des natifs choquaient la mentalité et les normes anglaises. DB a dû intervenir plusieurs fois pour délivrer des aborigènes d´un emprisonnement indu. (83) Ils étaient mis en prison pour des faits considérés criminels selon la loi des Blancs, dont ils ignoraient le contenu. Ils étaient condamnés aux travaux forcés, enchaînés les uns aux autres dans le système des gangs. Étant donné la violence des Blancs, les aborigènes craignaient leur approche, quels qu´ils soient, des scientifiques ou des médecins. (80-81) Pour eux tout Blanc était source de danger.
DB estime que :
« Rottnest Native Prison was only another tragic mistake of the early colonists dealing with the original inhabitants of a country so new and strange to them. [...] It was still a native prison when I was there in 1911[...] » (101)
Comme d´habitude, les aborigènes étaient incarcérés pêle-mêle, en groupes d´individus appartenant à des totems antagonistes. Lorsqu´elle y est allée, DB a demandé à être enfermée la nuit dans une cellule pour tenter de désamorcer les magies ennemies, « [...] which I did », dit-elle. (idem)
Sa connaissance des mœurs aborigènes faisait d´elle un atout précieux lors des ces mésententes inéluctables.
Daisy Bates fut un personnage connu et respecté : elle a rencontré le roi George V, a été présentée au Prince de Galles et au Duc de Gloucester quand il était gouverneur général d´Australie. Elle a reçu également, en 1934, la haute distinction de Commnader of the Order of the British Empire. (XIII) Cependant, quand la vieillesse arriva, le gouvernement lui alloua une pension ridicule de AU$ 4 hebdomadaires. (idem)
Mais elle n´a jamais attendu d´aide du gouvernement pour venir au secours des aborigènes: pendant une grave épidémie de varicelle, DB a pris en main les soins, mais aussi la cuisine et les corvées d´eau et de bois :
« I gave them medicine or food or whatever it might be. […] When all were convalescent, and everyone was inordinately hungry, the trouble with the children was the impossibility of my being able to feed them all ate once.” (75)
DB aimait ses aborigènes et se plaisait en leur compagnie, car si cela n´avait pas été le cas, elle ne serait certainement pas restée la plus grande partie de sa vie parmi eux. Depuis son premier contact avec les aborigènes, quand elle avait commencé à s´intéresser à leur systèmes de parenté, sur les bords de Sherlock River, elle ne s´était jamais plainte des différences de mœurs dans son livre, au contraire, c´était une source de plaisir et de découverte pour elle. Pourtant, après les avoir longtemps soignés pendant l´épidémie, elle avoue :
« And those awful huts! How we all escaped fever I don’t know. They lived, ate, slept in, and never moved out of these huts for days, and in all that stench one had to lean over to the patients, who might be huddled in their farthest corners, and inhale the germs of every filth producing disease.[…] I believe that in Heaven, in 40.000 years´ time, if somebody uncorks a bottle of native odour I shall be able to tell them the tribe it comes from.” (75-76)
Dans ses cinq différents campements, échelonnés dans le temps et l´espace, elle disposait d´une tente, quelques ustensiles et jamais – elle tient à le préciser – n´a eu de bonne ou des serviteurs.(8) Vivre ainsi n´était pas pour elle une corvée :
« A glorious thing it is to live in a tent in the infinite – to waken in the grey of dawn, a good hour before the sun outlines the low ridges of the horizon, and to come out into the bright cool air, and scent the wind blowing across the mulga plains [...] There was no loneliness. One lived with the trees, the rocks, the hills and the valleys, the verdure and the strange living things within and about them. My meals and meditations in the silence and sunlight, the small joys and tiny events of my solitary walks, have been more to me than the voices of the multitude […]” (99-100)
Que mangeait-elle ?
“My own fare, day after day throughout the years, has always been so simple that to myself I am a miracle.[…] A potato in the ashes now and again a spoonful of rice that nine times out of ten was burned […] occasionally the treat of a boiled egg, and always tea – my panacea for ills […]” (147)
Elle a donc vécu parmi les aborigènes non seulement pour les protéger, mais aussi pour les connaître. Ces années d´étude et de compilation de données, ont eu pour résultat non moins de 270 articles publiés dans des journaux et des revues scientifiques, intense travail de divulgation de ses observations et de son expérience anthropologique auprès des aborigènes. Un certain nombre de ses articles a été publié dans la presse australienne sous le titre général de My Natives and I.
Les Trappistes
Les religions s´étaient déversées sur l´Australie pour « sauver les âmes » des aborigènes, aidant ainsi à massacrer leur culture et leur mode de vie.
Ses pérégrinations ont amené DB a séjourner dans le premier monastère trappiste de la région Nord-Ouest, près de Beagle Bay où elle a fait plusieurs incursions avec les moines à l´intérieur des terres. La vie y était très dure, les moines avaient à peine à manger et travaillaient sans cesse pour maintenir le monastère en état, constamment détruit par les feux de brousse et les intempéries. Elle fait alors une comparaison révélatrice:
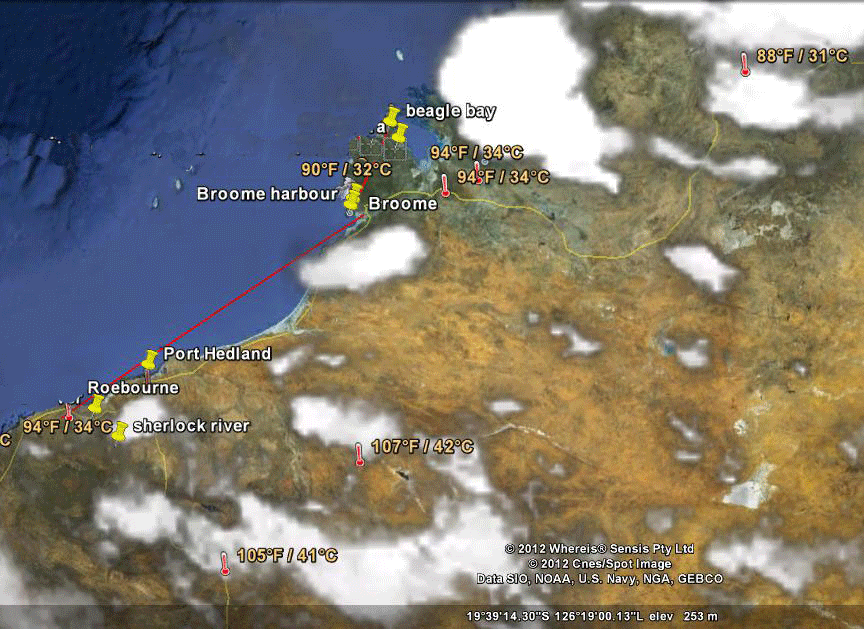
Google earth -Nord-Ouest de l´Australie.
Premier points de départ de DB (certaines distances elle couvrait par bateau, d´autres à cheval ou en buggy
« The horses were Trappists, too, skin and bone in their poverty. »(5)
Elle décrit ainsi le côté pittoresque de la Mission :
« I woke to hear the native singing a Gregorian cant in the little chapel near by. Half clothed and, for all for the untiring work of the missioners, still but half-civilized, they comprised the Nyool-nyool tribe, of the totem of a local species of snake. Most of the women and men had their two front teeth knocked out, and some still wore bones through their noses. Infant cannibalism was practiced, where it could not be prevented […]” (6-7)
DB écrit tout un chapitre sur son séjour au monastère. Elle aimait la vie qu´on y menait et participait aux travaux manuels, aux cérémonies des missionnaires et des natifs. Elle maintenait une position au-delà des fanatismes religieux, de la même façon qu´elle avait fait fi des conventions et des normes sociales de l´époque. Une femme libre d´esprit et libre de sa personne.
« Although I am an Anglican, I attended all religious ceremonies, morning and evening, during my stay, and loved to listen to the natives, with their sweet voices, intoning the Latin chants and responses as much as I loved to listen to their own weird music.» (12)
DB a travaillé 4 mois durant à la Mission, et a pu ainsi participer à toutes les réunions, aux jeux et aux travaux en général. Elle s´est fort amusée des imitations que les natifs faisaient des missionnaires, de leurs idiosyncrasies et de leurs tentatives d´accompagner, bien qu´à peine habillés, les rites des moines. Cela donnait lieu à des scènes hilarantes, comme par exemple des femmes nues avec un voile sur la tête. DB s´amusait :
« Standing behind them, close to the door for a breath of air, I tried in vain to maintain a solemn countenance and a reverent mien, only to explode at least once in choking laughter at the antics of one boy. Knowing that was behind him, he was at the same time desperately trying to keep his hands clasped in prayer, and a rag of decency well pulled down over his rear elevations.”(13)
Mais les natifs s´amusaient aussi:
« [...] I think I never made a more laughable toilet than that one. Every motion of mine, as I laced my corsets and eased my shoes on with a shoe-horn, brushed my hair and adjusted my high collar rand waist-belt, was greeted with long-drawn squeals of laughter and mirrored in action though the slim black daughters of Eve about me had not even a strand of hair string between the whole thirty. » (16)
Elle a accompagné l´évêque dans ses tournées, au cours de longues marches sous le soleil, sur les terres désertiques, parfois sans eau et peu de nourriture :
“Our only surveying instruments were the compass of an old lugger and a chain. The Bishop and I were the chainmen, and we walked in a steam heat, of 106 degrees at times, sometimes twelve miles in the day […] We were always hungry.” (12-14)
Sur le chemin de Disaster Bay, dont le nom s´est avéré très significatif, l´évêque s´est effondré d´exhaustion, tout le groupe a bu de l´eau contaminée et la dysenterie a fait des ravages. DB, précautionneuse, a fait bouillir son eau et a soulagé les malades avec le brandy de la bouteille qui l´accompagnait toujours pour des urgences comme celle-là. (15) Elle résistait vaillamment aux difficultés des chemins et n´a été malade que deux fois tout au long des 35 ans qu´elle a séjourné parmi les aborigènes. Et pourtant, elle n´a vécu que dans des campements, le plus souvent sur des terrains arides, sans arbre et l´eau toujours loin de portée.

Google earth- paysage d´Eucla
En 1912 elle s´établit à Eucla, (1912-1914) parmi les derniers membres de la tribu Mirning, au sud du plateau Nullarbor. (Wright, web) Toujours impeccablement vêtue, elle a également campé à Yalata (1915-1918) ainsi qu´à Wynbring Siding. C´est à Oldea qu´elle est restée le plus longtemps : 1918 à 1934.
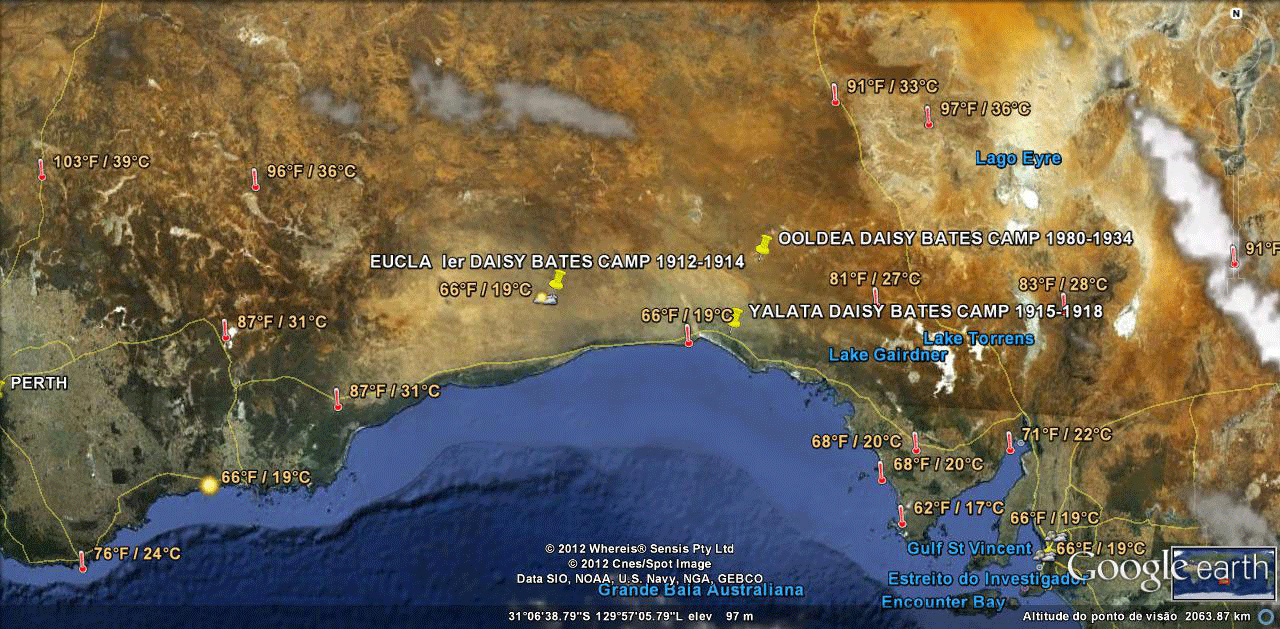
Google earth-Sud de l´Australie, les campements de DB, marqués avec des épingles jaunes
DB se déplaçait sans avoir peur des distances ni des moyens de transport disponibles : invitée à proférer une série de conférences par la section d´anthropologie de l´ Association for the Advancement of Science d´Australie (115-117), elle n´hésite pas à parcourir 402 km sur un buggy tiré par un chameau, afin d´y présenter son travail. (idem)
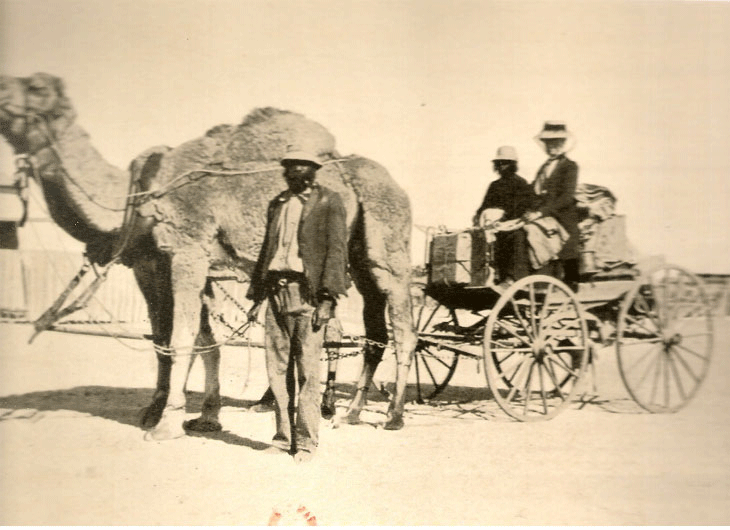
Elle s´est cependant pliée à des contraintes inexplicables, comme par exemple chevaucher en amazone, ce qu´elle-même considérait une ordalie. Elle a ainsi couvert, dans cette position, 1000 miles (1.600 Km), du Lake Eda à Ethel Creek pour conduire 770 têtes de bétail de sa propriété. Pour ce faire, elle avait engagé quelques conducteurs de bétail, et un cuisinier. Pendant six mois, placée à l´arrière du troupeau maintenu en forme de triangle, elle voit les 1000 miles devenir en réalité 3000, à force de tours et de détours qui s´avéraient nécessaires pour empêcher les défections.
Elle savait voyager avec peu de bagages:
« My equipment was a good English pig-skin side-saddle with ordinary stirrup; three pairs of laced wallaby-skin shoes; three habits, a felt hat, three pairs of riding gloves and plenty of fly veiling. A compact hold-all and portmanteau carried all necessaries, and was easily accessible on the dray, which also carried the stores for the trip and the drovers’ swags.” (43)
Le voyage a été ardu, le troupeau n´était pas habitué à boire de l´eau des puits et plus d´une fois le bétail, en débandade, rebroussa chemin dans l´espoir de retrouver ses pâturages habituels. (45) Ils chevauchaient 18h par jour avec une petite pause à midi, lorsque la chaleur devenait intenable. Cependant, DB ne réussissait pas à profiter du repos:
« Never able to sleep in the day-time, I seized this opportunity for explorations and collections of botanical and geological novelties, which I later forwarded to the museums.” (47)
Une fois arrivée à destination, DB voulut rentrer au plus vite à Port Herdland, mais elle ne trouva rien d´autre qu´une carriole qui transportait de la dynamite pour une mine ! « On est arrivé sans problèmes », a-t-elle affirmé. (50)
Aborigènes
Son travail la passionnait. DB s´est intéressée de près au système de parenté des aborigènes, qui pouvait être aussi bien matrilinéaire que patrilinéaire. Ils intégraient à leurs relations de parenté les étrangers les plus proches, à commencer par DB. En outre, la pratique ou non de la circoncision représentait un facteur déterminant dans l´appartenance à une tribu.
DB décrit un rituel au cours du quel elle a connu leur monde de magie et de rêve. (107-112) Un aborigène mourant lui a transmis sa magie sur une tige de bois d´acacia, sculptée en forme de femme – le bamburu censé la représenter, kabbarli, « woman of dream time ». (96)
Cette tige sculptée, explique-t-elle, me servait de passeport auprès de toutes les tribus de la partie centrale des terres. (idem) Elle dédie un chapitre entier aux rites des hommes, qui comprenaient 9 étapes d´initiation et pouvaient durer plusieurs années pour pouvoir accéder au monde des femmes, au mariage. (41)
À l´instar de la plupart des anthropologues, elle se penche principalement sur les rites masculins et pendant tout ce chapitre (34-41), on ne nous présente que les détails de leur initiation. Malgré l´importance de l´activité des femmes pour la survie des tribus, le masculin est, comme d´habitude, la base des observations anthropologiques. Rappelons ici, la division des tribus faite par DB selon que le penis était circoncis ou pas.
Margaret Mead, à partir de ses observations en Nouvelle Guinée fait le commentaire suivant :
« Or, le thème fondamental du culte initiatique c´est que la femme, en vertu de son pouvoir de faire des enfants, détient les secrets de la vie. Le rôle de l´homme est incertain, mal défini et peut-être inutile. Il a découvert, à grand-peine, une méthode pour compenser son infériorité fondamentale. Équipés de différents instruments mystérieux et bruyants, dont le pouvoir réside dans le fait que leur forme réelle demeure inconnue de ceux qui en entendent le son [,,,] ils peuvent enlever les enfants mâles aux femmes, les considérer comme incomplets pour pouvoir en faire eux-mêmes des hommes. Les femmes, il est vrai, font des êtres humains, mais seuls les hommes peuvent faire des hommes. Plus ou moins ouvertement ces rites sont des initiations de la naissance. » (Mead : 99)
On ne peut pas expliquer plus clairement la signification des rites masculins, des cases des hommes interdites aux femmes.
Des femmes anthropologues, comme Annette Weimer, ont fait des observations plus nuancées qui révèlent d´autres aspects sociaux lorsqu´on se penche sur l´aspect global des activités et pas seulement sur celles ayant trait aux hommes :
« Cela ne signifie pas qu´il suffit de compléter les études sur les hommes par des études sur les femmes, mais que nous devons recentrer notre attention sur ce qui est ‘constitué culturellement’ plutôt que sur ce que nous dictent nos catégories d´analyse sociale traditionnelle. » (Weimer, 1983 : 222)
Selon Schnitt-Pante, Annette Weimer a découvert et montré l´importance du rôle des femmes dans la société matrilinéaire des îles Trobriand[7], en étudiant les distributions des bouquets de feuilles de bananiers et de jupes de fibre que faisaient les femmes lors des cérémonies funéraires.
« L´observation de ces échanges d´objets appartenant aux femmes a permis de remettre en cause des ‘ faits’ préalablement établis touchant aussi bien la possession de la richesse, les échanges et la réciprocité, phénomènes considérés jusqu´alors comme uniquement masculins[...] Ces bouquets de feuilles et ces jupes ont en effet une double valeur matérielle et symbolique : ils légitiment la filiation, ils servent à mesurer l´importance des relations entre individus et entre familles, ils manifestent les principes de décomposition et de mort...Bref, dans la société Trobriand, la circulation de la richesse des femmes assure la reproduction et la régénération du matrilignage. » (Schnitt-Pante, 1984 : 99-101)
En effet, la compréhension des comportements et leurs imbrications vont bien au-delà de la description issue de l´observation. Mais cette compréhension est, elle aussi, traversée par les représentations sociales, par les images et les valeurs de l´observateur.
C´est ainsi que Annette Weimer, en tant que femme, s´est penchée sur les activités féminines qui avaient été considérées secondaires ou insignifiantes par les anthropologues masculins. Car, pour eux, ce qui importe est lié d´emblée, au masculin. Pauline Schnitt-Pante, par exemple, estime que :
« L´utilisation des concepts de ‘domestique’ et de ‘ public’ dans l´étude des rôles sexuels, appelle la même critique que celle faite de l´emploi des concepts de ‘nature’ et de ‘culture’. Cette opposition paraît être une nouvelle variante de la ‘réduction des catégories de sexe à leur définition biologique’ » (Schnitt-Pante, 1984 : 102)
Cette auteure considère également que la division sexuelle du travail et l´importance donnée au masculin est construite, car elle « [...] a été prise pour une description de la réalité sociale, alors qu´elle est souvent une construction idéologique qu´il faut étudier en tant que telle. » (Schnitt-Pante : 103) Il faudrait, ajoute-t-elle :
« [...] prendre en charge dans toute société l´analyse de l´ensemble des rôles assumés par les deux sexes, d´étudier l´articulation, propre à chaque culture de ces rôles et d´en tirer toutes les conséquences pour l´interprétation globale du système social. » (idem, 2)
Ce n´est donc pas la « nature » sexuelle des êtres qui détermine leur importance et leur place dans la société, mais bien l´imbrication culturelle des rôles. Même la notion de pouvoir est à revoir car, comme le souligne Foucault, le pouvoir est un exercice dont les limites dépendent de la structure sociale et n´est pas de l´ordre du biologique. C´est donc l´importance donnée aux attributs masculins qui créent, en fait, cette importance.
Ces notions de féminité et de masculinité sont donc des constructions sociétales et ne s´appliquent pas automatiquement à tous les groupes sociaux, surtout si l´on considère le « brouillage » sexuel qui peut intervenir dans certains cas.[8]
Pour Ruth Benedict, les méthodes anthropologiques souffriraient de l´établissement d´un référent – la civilisation occidentale – et d´un différent – les autres. Dans une vision très contemporaine, elle poursuit :
« L´anthropologie était, par définition, impossible aussi longtemps que de pareilles distinctions entre nous-mêmes et les primitifs, entre nous-mêmes et les barbares, entre nous-mêmes et les païens, s´imposaient à l´esprit des peuples. Il était d´abord nécessaire d´en arriver à ce degré de sophistication où nous n´opposions plus nos croyances aux superstitions de nos voisins. Il était nécessaire que ces institutions basées sur les mêmes prémisses, à savoir le surnaturel, fussent considérées ensemble, les nôtres avec les autres. » (Benedict, 1950 : 5)
DB expose les relations masculin / féminin comme étant une domination des hommes sur les femmes, selon l´interprétation habituelle de l´anthropologie androcentrique. Cependant, les nuances apparaissent lorsqu´elle fait la distinction entre les tribus des circoncis et des non- circoncis, car la liberté et les rôles sociaux des femmes étaient variables selon cette appartenance. (51)
Même la polygamie, dont elle signale plusieurs fois l´existence, est contrecarrée par une polyandrie fréquente. DB mentionne des cas où les femmes avaient même, l´une 7 et l´autre 14 maris. On peut voir cette dernière sur des photos de son livre. (60 et 74)
DB mentionne parfois l´échange et l´achat des femmes, mais son regard ne se pose que sur les actes des hommes. Est-ce que les femmes acceptaient ces pratiques ? Est-ce qu´elles n´avaient pas leur mot à dire ? Est-ce qu´elles ne décidaient pas avec qui elles voulaient rester ? Au début de la colonisation du Brésil, les Portugais trouvaient que les chefs indiens leur « donnaient » des femmes. Cependant, un regard plus approfondi sur les discours des colonisateurs montre que les femmes indiennes acceptaient librement leurs rapports avec les colonisateurs, car leur corps et leur sexualité leur appartenaient[9]. La sexualité y était libre et il n´y avait parmi les indigènes, comme souvent l´ont dit et répété les Portugais « ni Loi, ni Roi, ni Foi. »[10]
Ruth Benedict, déjà en 1950, notait que :
« La civilisation occidentale, [...] s´est répandue plus largement que tous les autres groupes locaux connus. Elle a imposé son modèle à la plus grande partie du globe, d´où cette croyance à l´uniformité du comportement humain, croyance qui, sans ces circonstances, ne serait jamais née. »(Benedict, 1950 : 6)
DB avait, toutefois, cette conscience de l´interférence de l´observateur sur le travail de terrain, ainsi que la nécessité d´un recul et de temps, pour ne serait-ce qu´effleurer les significations de leur langage et de leur comportement :
« The Australian follows the line of least resistance with the white man.[…] The first lessons I learned were never to intrude my own intelligence upon him and to have patience, the patience that waits for hours and years for the links in the long chain to be pieced together.” (90)
DB remarque l´existence du cannibalisme que l´on trouvait dans plusieurs tribus (92 /103-104), mais qui n´était pas une caractéristique propre aux aborigènes : les indiens du Brésil le pratiquait aussi à l´époque de la colonisation, au XVI siècle.[11] D´ailleurs, en plein XX siècle (1933), les déportés abandonnés à leur sort sur l´île de Nazino, en Sibérie, par le gouvernement communiste russe ont eu recours au cannibalisme pour leur survie.[12]
Tous les aspects de la coutume était à ses yeux importants, car en fait ce sont les traits culturels, socialement construits qui définissent un peuple. Donc, outre les comportements quotidiens, elle s´intéressait à la production de leurs représentations sociales, dont l´imagerie, les rêves et le symbolisme faisaient partie.
Ses notes et ses observations scientifiques étaient son bien le plus précieux. À côté des nombreux articles qu´elle a écrit, DB a réussi à établir les cartes des anciens chemins de nomadisme, en y précisant les points d´eau connus de leurs pères et de leurs grand-pères. Elle dessinait les tracés à partir d´un certain point et évaluait avec les aborigènes les distances selon les pauses pour dormir. (93)
DB a ainsi réussi à établir une cartographie des chemins aborigènes avant l´arrivée des Blancs, sur un grand nombre de cartes couvrant des centaines de kilomètres carrés. (93) On peut estimer que son travail anthropologique est, sans doute, le plus important pour la connaissance des peuples aborigènes, avant et après la présence des Anglais.
C´est ainsi qu´elle dévoile un intense commerce pratiqué jadis par les aborigènes sur tout le continent australien : chaque groupe avait 4 routes aux 4 points cardinaux, qui les menaient dans toutes les directions, afin d´échanger les produits de leur contrée. (106) Ils communiquaient entre eux par des signaux de fumée, permettant d´avertir des dangers, annoncer des visites ou des réunions.
Sa vie se déroulait au gré de la mobilité des aborigènes.
« […] I followed the nomads, seeking for camps, learning and noting the legends and relationships groups, and totems and way of life, and compiling my scientific data hand in hand with the unwitten literature of the race, so far as I could elicit it from shreds of songs and story. » (76)
Mais lorsqu´elle se trouvait basée quelque part pour un certain temps, les aborigènes faisaient des centaines de kilomètres pour venir voir leur kabbarli. (93-94)
Au fur et à mesure des années, la santé de DB a commencé à se détériorer : en 1918, elle a été obligée de se faire soigner à Adélaïde. (130) Une fois rétablie, elle a vite repris le chemin du bush, près de ses aborigènes. C´est à Ooldea, où elle avait passé le plus de temps -16 ans – qu´elle fut atteinte d´une maladie grave qui la rendit presque aveugle et elle fit encore 1000 miles pour consulter un oculiste à Perth, en 1922. (181) Toutefois, en 1941, âgée de 80 ans, elle est encore sous une tente au Wynbring Siding, près d´ Ooldea.
C´est là également qu´elle a subi la sécheresse la plus sévère de l´histoire de sud de l´Australie, selon son estimation. Huit ans sans pluie, (183) les puits à sec, l´eau de plus en plus éloignée, les incendies faisant rage. (199) Alors que tous fuyaient le feu, elle ramassait rapidement ses affaires les plus précieuses :
« It was for my precious manuscripts that I feared, the thousand notes and note-books that represented a lifetime’s ethnological work, accumulated through 35 years and thousands of miles of wandering.”(188)
Ce fut une époque très dure, où la température atteignit 52 degrés. (184) Son camp, à Ooldea, se trouvait près du chemin de fer Trans-Australian, dont le puits intarissable jusqu´alors attirait les aborigènes. Les réservoirs d´eau étaient réservés à l´usage du chemin de fer, près d´Ooldea, et il était interdit aux natifs de s´en approcher. Mais ce puits a commencé à donner de l´eau salée, suite à une exploitation intensive du chemin de fer et à la sécheresse qui s´est abattue sur la région.(182)
Les aborigènes étaient ainsi des exilés sur leur propre terre, privés de leur eau, donc de l´essentiel pour leur survie. Dans ce camp, DB s´est occupée surtout de prodiguer des soins aux malades, aux éclopés, aux laissés-pour-compte. Comme d´habitude.
DB devait charrier son eau sur plusieurs kilomètres. « I could never accomplish more than eight gallons in one journey [...] » explique-t-elle! (183) Sa subsistance, en fait, était assurée par la publication de ses articles, mais dans ces conditions, écrire était devenu impossible. Mais elle résista.
Lors des échauffourées qui ont mis le Nord de l´Australie en ébullition, elle fut appelée par le Ministre de l´Intérieur, en 1933, afin de les conseiller sur les décisions à prendre. Ils cogitaient même de l´envoyer en personne, sur place, dans le but de prendre le pouls de la situation. Mais elle avait déjà 74 ans et ils n´ont pas osé lui donner cette tâche si ardue, sur des contrées sauvages. (196-197)
Elle a au moins profité des « conforts » de la modernité :
« In haste I left my camp on the next passing express, and two days later enjoyed the first bath worthy of the name in twelve years – three quarts of water in a kerosene `bucket´ cut lengthwise being the most luxurious that Ooldea, at its best, could provide. » (196)
Quelque temps plus tard elle recevait la distinction de The Order of Commander of the British Empire. (197)
Quelle femme! Quelle fierté et indépendance ! Quelle force et endurance ! Quel courage ! Son aventure a été sa vie. Elle a suivi ses choix, creusé ses sillons, s´est construite en un personnage hors pair, une scientifique qui ne dédaignait pas l´action. Dans ce milieu inconnu, parmi des natifs revêches mais oh ! combien craintifs et fragiles, DB est devenue leur port d´ancrage et de salut. Tant de fois elle les a soignés, alimentés, apaisés ! Et aimés.
DB montre que la compassion n´a pas besoin de religion, des dieux qui ordonnent et châtient. Elle a ouvert les bras aux plus faibles et sa récompense a été leur confiance.
Daisy Bates meurt le 18 avril 1951 à l’âge de 91 ans.
Quelle aventure!
Références bibliographiques
Daisy Bates, s/d. The passing of the aborigines, New York, Pocket Books
Alexandra Lapierre, Christie Molichard, 2007, Elles ont conquis le monde. Les grandes aventurières, 1850-1950, Paris :Arthaud
Paola Tabet1998, La construction sociale de l´inégalité des sexes, des outils et des corps. Paris :L´ Harmattan
Margaret Mead. 1966, L´un et l´autre sexe, Paris : Denoël / Gonthier
Ruth Benedict, 1950. Échantillons de civilisation (éditon élétronique
Pauline Schnitt-Pante, 1984.La différence des sexes, histoire, anthropologie et cité grecque, in Michelle Perrot,(dir) Une histoire des femmes est-elle possible ? Paris : Rivages
Annette Weiner. 1983.La richesse des femmes ou comment l´esprit vient aux hommes, Iles Trobiand. Paris : Seuil
R. S Wright. Bates, Daisy May (1863-1951) http://adb.anu.edu.au/biography/bates-daisy-may-83
Julia Blackburn. 1997 Daisy Bates in the Desert, Great Britain:Vintage.
Note biographique:
site: www.tanianavarroswain.com.br
tania navarro swain professora da Universidade de Brasília, doutora pela Université de Paris III,Sorbonne. Fez seu pós-doutorado na Universidade de Montréal, onde lecionou durante um semestre .Na Université du Québec à Montréal, (UQAM), foi professora associada ao IREF, Institut de Rechereches et d´Études Féministes. Criou, na Universidade de Brasília, o primeiro curso de Estudos Feministas no Brasil, na graduação e na pós-graduação,em níveis de Doutorado e Mestradol, iniciado em 2002. Publicou, pela Brasiliense, “O que é lesbianismo”, 2000 , organizou um número especial “Feminismos: teorias e perspectivas” da revista Textos de História, lançado em 2002. Organizou igualmente os livros “História no Plural” e "Mulheres em ação: práticas discursivas, práticas políticas" publicado em 2005 pela editora das Mulheres além de "A construção dos corpos, em2008. Tem dezenas de publicações em revistas nacionais e internacionais, bem como capítulos de livros. ( ver site www.tanianavarroswain.com.br) É editora da revista digital Labrys, estudos feministas".
[4] Voir l´oeuvre de l´historien Henry Reynolds, par exemple: The other side of the frontier: Aboriginal resistance to the European invasion of Australia (1981) Sydney: University of New South Wales Press Ltd http://books.google.com.br/books?id=5UT3CuOmPmEC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ou Frontier: Aborigines, settlers and land (1987) Sydney : Allen & Unwin
[6] Cette image est du domaine public car son copyright a expiré.
[7] Les études de Malinowski aux îles Trobiand sont souvent considérées le degré zéro de l Ethnologie .
[8] Voir mon article sur les indiens au Brésil, qui choisissaient le sexe qu´ils/ elles voulaient incorporer socialement.
[9] Voir par exemple article de l´auteure http://www.tanianavarroswain.com.br/francais/amazonesfr.htm
[10] idem
[11] Voir , par exemple, STADEN,, Hans,, 1520-1565 Viagem ao Brasil.
- Rio de Janeiro : Academia Brasileira,, 1930. - 186 p. http://purl.pt/151
http://purl.pt/151/cover.get
[12] Voir Nicolas Werth, 2008. L´Île aux cannibales, Paris:Perrin
[13] Published by the
SOUTH AUSTRALIAN MUSEUM ARCHIVES
on the
South Australian Museum website, 2004

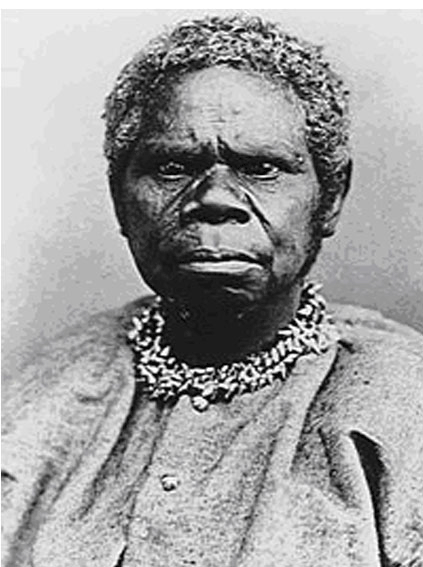
 [13]
[13]